Étude spéciale
REVUE DE FIN D’ANNÉE
par P. Cross*
Introduction
L’année 2002 a été insigne pour l’économie
canadienne, les taux respectifs de progression du PIB et de l’emploi
s’élevant à 3,4% et à 2,2%. Cette
progression est d’autant plus exceptionnelle lorsqu’on
compare le Canada aux autres pays du Groupe des Sept où,
en moyenne, les taux de croissance de la production ont été de
seulement 1%. Les États-Unis ont fait oublier une année 2001
où leur économie avait pour ainsi dire piétiné,
en affichant un taux de croissance de 2,4% l’an dernier,
mais ils étaient encore très loin des cinq années
précédentes, où leur économie avait
crû à un rythme annuel approximatif de 4%. Par ailleurs,
la première année de la monnaie commune a vu la croissance
ralentir dans la zone de l’euro à moins de 1% à cause
de la faiblesse persistante des économies allemande et française.
Enfin, le Japon est demeuré à la traîne avec
un maigre taux de croissance de 0,3% en volume; une fois prise
en compte une déflation qui perdure, on constate que le
PIB de ce pays a rétréci en dollars courants une
deuxième année de suite.
La performance économique supérieure du Canada n’a rien d’un
phénomène récent. Depuis 1995, aucun grand pays membre de
l’OCDE n’a mieux fait que notre pays, dont le taux cumulatif s’élève à 28%
pour le PIB1 trimestriel. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les taux correspondants
ont été de 26% et 20%; la zone de l’euro et le Japon se situaient
loin derrière, à 16% et 8%. Que le Canada soit capable de se soustraire
aux maux de son principal partenaire commercial et de croître sans
discontinuer a étonné les prévisionnistes l’an dernier,
mais son taux de croissance a en fait dépassé le taux américain
quatre années de suite. En fait, l’écart canado-américain
d’un point de pourcentage du taux de croissance l’an dernier n’était
pas plus remarquable que les différences de 1,3 et 1,2 point relevées
en 1999 et 2001 (l’écart a été de 0,7 point en
l’an 2000)2. L’écart canado-américain par habitant
est encore plus grand (5 points depuis 1997) et s’explique par une croissance
démographique plus rapide aux États-Unis.
À l’instar des années, les cycles économiques ont
leurs traits distinctifs. Pendant la récente contraction de l’économie
américaine par exemple, l’indicateur de la productivité a
présenté ses meilleurs résultats de l’histoire pour
une période de récession. Au Canada, la croissance de l’économie
s’est poursuivie en dépit du marasme dans le secteur de l’investissement
qui aurait normalement dû déclencher un déclin prononcé.
Il reste que bien des événements récents ne peuvent se comprendre
que dans le contexte de ce qui a été le moteur du dernier cycle, à savoir
l’ascension et la chute boursières. Nous entreprendrons donc de
dresser le bilan de cette année en donnant un aperçu de l’évolution
récente des marchés financiers dans le monde. Notons enfin que
ces événements cycliques ont pour toile de fond des tendances à plus
long terme de notre société, et plus particulièrement le
mouvement de vieillissement de sa population et l’instruction des femmes.
Nous passerons en revue cet état des choses plus en détail lorsque
nous parlerons de l’évolution du marché du travail.
Figure 1

Marchés financiers
Les bourses florissantes des dernières années de
la décennie 1990 aux États-Unis ont planté le
décor pour un grand nombre de tendances économiques
de notre époque. Les décisions d’épargne,
d’investissement et d’emprunt se sont trouvées
déformées par des attentes peu réalistes
quant à l’avenir de la demande et des bénéfices
(à preuve l’effondrement des cours boursiers qui
a suivi et le nombre record de faillites). La bulle a rendu le
capital artificiellement bon marché, incitant ainsi les
entreprises à surinvestir. Cette constatation vaut particulièrement
pour les démarrages d’entreprises de technologie,
les capitaux de risque ayant délaissé les investissements
productifs pour se déverser dans des émissions
initiales d’actions qui « se sont dissipées
en logiciels inutiles, en aventures « pointcoms » et
en lignes à fibre optique inutilisées [TRADUCTION] ».3
La distorsion a été si excessive qu’elle a amené les
gens à penser que le cycle économique était mort. Partout
où des problèmes sont apparus, qu’il s’agisse de la
crise en Asie de l’Est en 1997 ou de celle du fonds LTCM en 19984, les
investisseurs ont été secourus, ce qui a renforcé l’idée
que les anciennes règles économiques ne valaient plus dans la nouvelle économie,
rappel des mots d’ordre d’« ère nouvelle » et
de « monde nouveau » par lesquels on avait justifié les
effervescences artificielles du marché antérieurement dans le siècle.5
On peut déplorer que le goût de l’innovation se soit reporté de
la technologie vers des pratiques comptables de plus en plus imaginatives.
Un effet secondaire de la « mentalité de bulle » a été l’avènement
d’une culture de cupidité contagieuse dans les entreprises, pour
reprendre l’expression d’Alan Greenspan, président de
la Réserve fédérale américaine. La flambée
des cours boursiers a encouragé la spéculation et les excès
d’options de participation et suscité des problèmes de régie
d’entreprise. La manie boursière dans la technologie a culminé au
début du nouveau millénaire. Le Nasdaq a vu ses cours presque doubler
encore en moins de cinq mois, soit de novembre 1999 à février 2000,
après avoir presque doublé durant l’année ayant précédé.
Que la bulle ait crevé par la suite a engendré un cercle vicieux. À mesure
que décroissaient les cours boursiers et que ralentissait la croissance économique,
la tentation s’est faite plus forte dans certaines entreprises d’induire
le marché en erreur au moment de déclarer des rendements défaillants. À l’évocation
triomphaliste d’une nouvelle économie ont succédé des
nouvelles de faillites aux États-Unis : Worldcom, Enron, Global Crossing
et Adelphia. Ce que ces scandales avaient en commun, c’est qu’ils étaient
concentrés dans des secteurs qui avaient récemment connu la déréglementation
aux États-Unis (en particulier ceux des finances, des télécommunications
et de la vente d’électricité).
L’insistance sur la succession de problèmes de régie d’entreprise
en 2002 a fait encore plus s’effondrer les cours boursiers. Sur le marché américain
(mesuré par le S&P 500), ceux-ci ont perdu 23,4% dans l’année,
accusant leur pire baisse depuis 1974. C’était aussi la première
fois que les cours descendaient trois ans de suite depuis les années 1930.
Dans l’ensemble, le marché boursier avait perdu en fin d’année
40% de sa valeur depuis le 31 décembre 1999. Les actions technologiques
ont été le plus rudement touchées et l’indice Nasdaq
a reculé de 70%. De même que le krach des années 1930
avait donné naissance à la Securities Act de 1933 et à la
SEC, de même le Congrès a promulgué la loi Sarbanes-Oxley
avec ses nouvelles règles de régie d’entreprise.
Les bourses américaines ont été étrillées
en 2002, mais nombreuses ont été les bourses européennes
et asiatiques à subir un sort pire encore. L’affaissement de la
demande et les dévoilements de scandales ont fait littéralement
fermer les bourses technologiques de l’Allemagne et du Japon. Dans l’ensemble,
l’indice mondial des cours boursiers Morgan Stanley’s a marqué un
recul de 20% l’an dernier, le pire depuis 1974; c’est ainsi qu’il
a perdu 43% au total depuis l’an 2000, c’est-à-dire depuis
la plus haute effervescence des actions de la technologie, de la médiatique
et des télécommunications (la seule période où la
perte a été encore plus cuisante (59%) a été les
années 1929-1931). Précisons que, par comparaison, la bourse
de Toronto, qui a pourtant connu ses premières baisses consécutives
depuis 1973-1974, s’en est relativement bien tirée, présentant
une perte de seulement 26% depuis deux ans, dont 14% l’an dernier. Cela
s’accorde avec le constat de la supériorité canadienne au
sein du Groupe des Sept pour ce qui est de la croissance économique.
L’état lamentable des finances des sociétés peut aussi
se mesurer par l’écart de rendement entre les obligations respectives
des entreprises et des administrations publiques. Dans le monde, les défauts
de paiement ont atteint, selon la Banque du Canada, des niveaux records dans
le cas des obligations des sociétés6. Au Canada, l’écart
de rendement secteur public-secteur privé a pris l’an dernier la
proportion record de 160 centièmes, en hausse donc sur son minimum
le plus récent de 50 centièmes en 1997 (juste avant la crise
en Asie et celle du LTCM). C’est dire que, en réalité, les
entreprises n’ont pu profiter ces dernières années de la
faiblesse des taux d’intérêt à long terme (contrairement
aux administrations publiques et aux ménages), d’où leur
nouvelle plus grande aversion pour l’endettement. Aux États-Unis,
un nombre record de sociétés dont les valeurs étaient recommandées
sont aujourd’hui considérées comme des entreprises à « valeurs
de pacotille ». Une autre proportion de 45% se situait seulement au
niveau immédiatement supérieur à BBB. Ce contingent est
le plus nombreux depuis 1988. De telles entreprises se soucieront sans doute
de ravaler leurs bilans pour éviter d’être exclues de fait
des marchés boursiers par leur déclassement au rang d’« investissements
de pacotille ». Une autre conséquence de la faiblesse boursière
a été la multiplication des fonds de retraite sous-capitalisés à prestations
déterminées dans les grandes entreprises. À l’instar
des actions, les obligations des sociétés européennes ont
subi un déclassement encore pire l’an dernier.
Figure 2
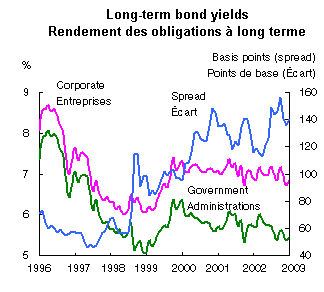
Mentionnons enfin que le dollar américain a commencé à perdre
de sa suprématie. En pondération des échanges,
sa valeur a légèrement baissé par rapport
aux principales monnaies. Le dollar américain avait monté en
flèche de 28%, porté par une vague de fond de placements étrangers
sur les marchés des capitaux de ce pays. (Il est intéressant
de remarquer que les États-Unis ont maintenu l’excédent
du revenu d’investissement en 2002 malgré l’ascension
rapide de la dette extérieure, ceci parce que le taux
de rendement sur leurs actifs à l’étranger
est supérieur à celui qu’ont réalisé les étrangers
avec leurs investissements aux États-Unis.)
L’effondrement des cours boursiers a eu de grands effets économiques;
il a notamment causé un tarissement des sources de capitalisation des
nouvelles entreprises. Comme nous l’avons dit, chaque cycle économique
a cependant ses traits distinctifs et un des traits les plus marqués de
cette déroute boursière est qu’elle n’ait pas plongé le
système financier dans une crise.
La capacité de ce système à composer avec la montée
des défauts de paiement d’obligations et la descente des marchés
boursiers s’expliquent, d’après la Banque du Canada, par l’efficience
de la redistribution des risques (Revue du système financier, page 6-7).
Les banques sont bien moins exposées directement, et ce sont les investisseurs
qui, plus souvent qu’à leur tour, sont là pour absorber les
pertes, surtout dans le cas des émissions initiales d’actions. Les
provisions moyennes pour pertes sur prêts des banques canadiennes, qui
se situaient au niveau de 0,2% de l’actif en 1997, se trouvaient toujours
au niveau relativement bas de 0,6% en 2002 et un taux élevé de
recouvrement des créances douteuses témoignait de la bonne qualité de
leurs avoirs.
Investissement
Le mouvement d’ascension et de chute de l’investissement des entreprises
a été des plus prononcés aux États-Unis, où les
dépenses des entreprises en installations et en outillage ont constamment
diminué pendant huit trimestres entre l’an 2000 et la fin de
2002, dans ce qui devait être leur plus long marasme, à 12%, (mais
non leur plus noir) depuis la grande crise des années 1930. Cette
période avait été précédée de six années
où le taux de progression de ces dépenses s’était établi
en moyenne à 10%. La chute s’est amorcée dans les dépenses
d’outillage lorsque le tarissement des sources de capitalisation et la
chute de la demande ont douché l’engouement pour l’informatique
et les télécommunications. Les coupures ont bientôt gagné les
dépenses en usines et en immeubles de bureaux et se sont encore accentuées
en 2002 à mesure que se renforçait le phénomène cyclique
classique des surcapacités. La réduction des investissements s’est étendue
de l’outillage et des logiciels à la construction non résidentielle
tant au Canada qu’aux États-Unis.
Le recul de l’investissement a été moindre au Canada, tout
comme le recul boursier. Bien sûr, les deux phénomènes étaient
liés. Les entreprises canadiennes n’ont pas surinvesti dans la technologie
de l’outillage comme les entreprises américaines et, par conséquent,
la chute qui devait suivre y a pris des proportions moins alarmantes avec une
valeur totale de 5% en volume de 2000 à 2002. Les entreprises ont freiné davantage
leurs dépenses sur le plan des biens technologiques. Les usagers de matériel
de télécommunications ont subi la plus grande dépression
en raison de la surcapacité, dégringolant de 22% en volume en 2002
après une chute de 10% l’année précédente.
Par contre, la demande d’ordinateurs s’est stabilisée pour
une deuxième année de suite, après avoir grimpé de
40% en moyenne par année, de 1994 à 2000. Même les dépenses
en logiciels ont ralenti à moins de 10% de croissance pour la première
fois depuis 1995. Entre temps, les structures non résidentielles ont fondu
de 6% après avoir pratiquement stoppé en 2001. Un excédent
de locaux d’usines et de bureaux a fait baisser la construction de nouveaux
immeubles de 11%, tandis que le secteur de l’ingénierie souffrait
des contraintes dans l’industrie pétrolière. (Le secteur
de l’énergie à lui seul représente près de
la moitié des bâtiments non résidentiels au Canada.)
L’an dernier, la faiblesse des investissements des entreprises par industrie était
concentrée dans le secteur TIC et le secteur des ressources naturelles
(en baisse d’environ 3 milliards et 2 milliards respectivement) à la
suite, dans l’un et l’autre cas, d’une vive contraction de
la demande mondiale. L’affaissement des investissements en haute technologie
s’est accéléré après un premier ralentissement
en 2001. La fabrication d’ordinateurs et de produits électroniques
a été le plus durement touchée et, dans ce secteur, les
dépenses d’investissement ont été amputées
de 43% de leur valeur. La presque totalité de ces baisses ont eu pour
origine l’industrie du matériel de télécommunication
en chute libre de 74%. Dans les secteurs professionnel, scientifique et technique,
la conception de systèmes informatiques a régressé de 15%.
Dans le secteur de la recherche scientifique, le dérapage a été de
44%, ce qui devait effacer en majeure partie le gain de l’année
précédente. Le marasme de la demande de services de télécommunication
a aussi joué un rôle dans le recul de 17% (ou de 2 milliards
de dollars) qu’a subi l’industrie de la radiodiffusion et des communications.
Toutes les industries de ressources naturelles ont fortement comprimé leurs
dépenses d’investissement. On relevait les plus grandes baisses
dans l’extraction, la fonte et l’affinage de métaux, le bois
d’œuvre et le papier. Le facteur des baisses de prix a clairement
joué dans ces réductions, mais dans d’autres secteurs des
hausses de prix n’ont pas empêché de sabrer les dépenses
en immobilisations. Cette constatation vaut particulièrement pour le secteur
pétrolier et gazier où les diminutions constatées pour les
projets classiques ont eu plus de poids que les augmentations observées
pour les projets extracôtiers et les projets de mise en valeur des sables
asphaltiques. Par ailleurs, la fermeté de la demande dans les mines non
métalliques ne s’est pas traduite par un accroissement des dépenses
d’investissement.
L’investissement a été peu ferme dans bien d’autres
industries des plus capitalistiques au Canada. L’industrie de l’automobile
a freiné ses investissements après les avoir largement accélérés
l’année précédente, alors que le commerce de détail
et les finances comprimaient leurs dépenses une deuxième année
de suite. Deux exceptions dignes de mention sont les transports aériens
et les services publics. On a aussi remarqué un ample redressement des
dépenses d’investissement du secteur public, notamment dans les
domaines de l’éducation et de la santé.
Le motif évident de la réduction des dépenses en immobilisations
des entreprises était de remettre en état leurs finances. Ainsi,
le secteur des sociétés a passé de sa position traditionnelle
d’emprunteur de montants nets à celui d’important prêteur
de montants nets pendant chacune des deux dernières années. Les
entreprises canadiennes n’étaient pourtant pas les seules à poursuivre
ces objectifs, puisque de telles tendances s’écartant des emprunts
des entreprises ont été constatés tant aux États-Unis
qu’au Royaume-Uni7.
Ce qu’on doit entre autres noter à propos des remous récents
des bourses est que leur effet sur les dépenses s’est trouvé directement
concentré dans les investissements mêmes plutôt que dans les
dépenses des ménages. Les émissions d’actions des
entreprises ont monté en flèche à 54 milliards de dollars
au Canada en l’an 2000 – ce qui équivaut à environ
40% des nouveaux investissements – avant de tomber à 31 milliards
en 2002. L’absence d’effet de richesse perceptible sur les dépenses
des ménages est en partie attribuable à l’essor des prix
de l’habitation.
Marchés du travail
Si l’évolution récente de l’économie réelle
a eu pour toile de fond le cycle contrasté en crête et en creux
des marchés financiers, l’évolution du marché du travail
s’est détaché sur le fond d’une tendance au vieillissement
de la population. À l’intérieur de l’augmentation globale
de 330 000 personnes de 15 ans et plus l’an dernier, il y a eu
un mouvement vers la tranche d’âge des plus de 45 ans, où l’accroissement
s’est un peu accéléré pour atteindre 310 000.
Une quatrième baisse consécutive du groupe d’âge mûr
de 25 à 44 ans a largement compensé une modeste hausse du
nombre de jeunes de 15 à 24 ans. Le groupe d’âge qui
a le plus progressé en nombre est celui des 55 à 59 ans (augmentation
de 114 000, le plus pour tout décile de 5 années d’âge
entre 15 et 64 ans). Il était suivi à cet égard du
groupe 45-49 ans (augmentation de 95 000). Dans l’un et l’autre
cas, il faut y voir le constant cheminement de la génération du
boom des naissances dans la pyramide des âges. Le nombre de gens ayant
dépassé l’âge normal de la retraite de 65 ans
n’a pas encore commencé à s’accroître rapidement,
en partie à cause d’une quatrième baisse consécutive
de l’effectif de la tranche 65-69 ans.
Figure 3

Le comportement des travailleurs plus âgés sur
le marché du travail semble déjà devoir être
en divergence nette avec les tendances constatées depuis
des décennies. C’est un développement qui
devrait se maintenir à mesure que le marché du
travail s’adaptera à la réalité d’une
main-d’œuvre qui vieillit. L’âge moyen
de la retraite a un peu monté depuis quatre ans, passant
d’un minimum de 60,9 en 1998 à 61,2 l’an dernier,
ce qui mettait fin à un incessant mouvement de diminution,
lequel était de 65 ans vers la fin des années 1970
(où a débuté la série actuelle de
données). Une baisse du revenu d’investissement
au moment où les taux d’intérêt reculaient
et que les marchés boursiers chutaient pourrait avoir
rendu nécessaire à certains employés âgés
de travailler plus longtemps. Ce retour à des valeurs
positives semble s’expliquer plus par l’offre de
main-d’œuvre que par une évolution spontanée
de la demande, puisqu’il s’est opéré simultanément
dans l’emploi privé et public et dans le travail
indépendant8.
C’est aussi ce qu’on constate lorsqu’on regarde de plus près
les taux d’activité des groupes d’âge. Les taux ont
le plus augmenté l’an dernier dans le groupe de plus de 54 ans
avec une hausse de 1,9 point qui dépassait le gain cumulatif des
quatre années précédentes (qui contrastaient déjà vivement
avec deux décennies de décroissance ininterrompue). Le groupe 60-64 ans
a tout particulièrement relevé son taux d’activité (3,4 points),
le portant à son plus haut niveau en près de 20 ans. Dans
le groupe 65-69 ans, le gain a été de 1,6 point, un sommet
depuis 1982. À ces hausses des taux d’activité ont presque
parfaitement correspondu des hausses des taux d’emploi, d’où l’impression
que la certitude de trouver un emploi a beaucoup joué comme facteur, les
gens voulant éviter les longues périodes de chômage pendant
qu’ils étaient en quête de travail. La disponibilité accrue
d’emplois à temps partiel ne semble pas avoir été un
facteur important, puisque l’emploi à plein temps a progressé plus
rapidement (bien que les travailleurs de plus de 65 ans se tournent de plus
en plus vers l’emploi à temps partiel contrairement à ce
qu’ils avaient l’habitude de faire dans les années 1990).
Figure 4
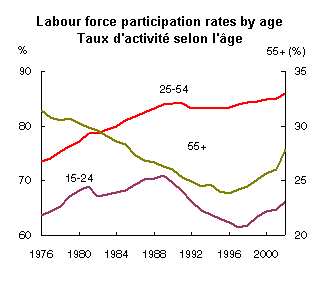
Il faut cependant noter que le petit nombre de travailleurs âgés
en chômage ont été chômeurs le plus
longtemps. Dans ce groupe, la période de chômage
a été la plus longue de tous les groupes, à presque
31 semaines comparativement à une moyenne d’environ
18 semaines. C’est peut-être que les travailleurs
plus âgés sont plus sélectifs au moment d’accepter
un emploi, ce que leur permettrait une meilleure situation financière
créée par des économies ou des prestations
de retraite plus abondantes (autre possibilité :
ces personnes pourraient avoir plus de difficulté à trouver
du travail)9. Les conséquences sont importantes si les
employeurs comptent sur les travailleurs plus âgés
pour le maintien de la croissance de la main-d’œuvre
au gré du vieillissement de la génération
du boom des naissances.
Un autre changement que tiennent souvent pour acquis les analystes et qui est
fondamental dans les tendances récentes de la population active est la
féminisation du travail. Près de la moitié (46,1%) de la
main-d’œuvre est aujourd’hui féminine et les taux d’activité des
femmes continuent à croître plus vite que ceux des hommes, notamment
chez les adultes. En 1976, l’activité des femmes d’âge
adulte était de la moitié seulement de l’activité de
leur pendant masculin (41% contre 81%), elle était de bien moins de la
moitié dans le cas des femmes de plus de 45 ans. Une génération
plus tard, l’écart n’est invariablement que d’environ
10 et 15 points respectivement pour les femmes de 25 à 44 ans
(81,2% contre 92,4% chez les hommes) et les femmes plus âgées. On
doit tous ces gains surtout aux femmes mariées. Ajoutons que le taux d’emploi à temps
partiel a perdu quelques points chez les femmes adultes, alors qu’il augmentait
de 3,7 points chez les hommes10.
Les femmes sont plus nombreuses à entrer sur le marché du travail,
mais elles accèdent aussi à l’activité en jouissant
d’une meilleure instruction. L’an dernier pour la première
fois dans l’histoire, plus de femmes que d’hommes dans la population
avaient fait au moins des études postsecondaires incomplètes. En
un peu plus d’une décennie, la proportion de femmes ayant fait plus
que des études secondaires a monté de 39,7% à 53,3%. Depuis
1999, le nombre de femmes âgées de 25 à 44 ans possédant
un diplôme universitaire a dépassé celui des hommes (s’élevant à près
de 100 000 femmes, soit près de 10% plus que les hommes l’an dernier),
ce qui renverse l’avantage traditionnel que détenaient les hommes
plus jeunes sur les femmes. C’est une tendance qui devrait s’accentuer à court
terme, à en juger par le nombre de femmes qui fréquentent l’université.
Alors que la demande pour les diplômés universitaires a continué d’augmenter
(mais à un taux moindre que la moyenne de 5 % de la fin des années
1990), elle n’a pas comblé l’offre. Par conséquent,
l’an dernier pour la première fois depuis que de telles données
existent, ils ont été le seul groupe d’instruction dont le
taux d’emploi a baissé dans ce qui est depuis quatre ans l’inversion
d’un mouvement de progression de l’emploi qui a duré une décennie.
Ces quatre baisses consécutives ont ramené le taux d’emploi
du groupe d’instruction universitaire de 79,1% en 1998 à 77,4% en
2001 et à 77,1% l’an dernier, niveau le plus bas jamais atteint.
(Ce qui étonnera encore plus, c’est que les gens de 25 à 54
ans et ceux ayant fait des études universitaires supérieures ont
perdu le plus d’emplois.) C’est ainsi que le taux de chômage
du groupe d’instruction universitaire s’est accru d’un point
entier pour s’établir à 5%11. Cette montée du chômage
a eu lieu tant chez les hommes que chez les femmes, car les possibilités
d’emploi n’ont pas suivi l’accroissement numérique de
ce groupe : le nombre de travailleurs s’est élevé de
19% depuis quatre ans et le nombre d’emplois, de 18%. Il reste que le nombre
d’emplois a augmenté deux fois plus vite que dans tout autre groupe
(7% comparativement à une hausse de 6% seulement de la population active).
Le seul autre groupe qui ait vu son taux d’emploi décroître
ces dernières années est celui des seules études primaires,
et ce, malgré un léger redressement observé l’an dernier.
Figure 5

Tous les groupes situés entre les plus et les moins instruits
ont vu leurs taux d’emploi évoluer en hausse depuis
1997, mouvement qui durait encore en 2002. Les diplômés
de l’école secondaire ont mené le mouvement
avec un taux d’emploi en hausse de 1,9 point depuis
cinq ans. Ils étaient suivis de près des titulaires
d’un certificat d’études postsecondaires et
de ceux qui n’avaient pas terminé l’école
secondaire. La persistance de cette tendance au gré de
l’évolution du cycle économique et dans un
mouvement de progrès rapide de la technologie demeure
une énigme du marché du travail. Soulignons que
la convergence qui s’opère entre groupes d’instruction
ne doit pas nous cacher la réalité que, en valeur
absolue, l’emploi monte, les gains progressent et le chômage
descend à mesure que s’élève le niveau
de scolarité. Il est néanmoins notable que, dans
une société qui est axée davantage sur le
savoir, les mouvements de l’emploi soient mieux répartis
après avoir divergé pendant le plus clair de la
décennie 1990.
En distinguant la population active ayant fait des études secondaires
ou moins de celle qui a fait au moins des études postsecondaires incomplètes,
on peut mieux voir en résumé comment ces tendances ont évolué depuis
dix ans. De 1993 à 1997, les moins instruits ont constamment perdu des
emplois (pour un total de presque un demi-million ou 1 % en terme de leur taux
d’emploi) et les plus instruits en ont gagné 27%, ce qui a laissé leur
taux d’emploi inchangé. Depuis cette dernière année,
l’emploi a augmenté dans le groupe des études secondaires
ou moins, ce qui a élevé leur taux d’emploi de 3,0 points.
Pendant ce temps, la progression de l’emploi chez les plus instruits ralentissait
en 2001 et 2002, y présentant ses gains consécutifs les plus modestes
jamais relevés, sans doute partiellement à cause du marasme de
la demande dans les industries de haute technologie. Malgré tous ces remous,
on doit noter que les taux de chômage de ces deux groupes sont pour ainsi
dire revenus à leurs niveaux respectifs de 10,2% et 6,0% en 1990, reflet
de la diminution du nombre de travailleurs moins instruits et de la progression
plus rapide du nombre de travailleurs ayant fréquenté les établissements
postsecondaires.
De l’examen du tableau de la croissance par industrie, on peut tirer des
indices quant à la divergence moindre entre les niveaux d’instruction.
Soutenue par le marché florissant de l’habitation, l’industrie
de la construction a vu bondir de 5% le nombre de ses emplois l’an dernier
pour un gain global de 20% depuis 1998. Les emplois en construction sont aujourd’hui
les plus nombreux de l’histoire et, dans cette industrie, le taux de chômage
a glissé sous la barre des 10%. C’est moins de la moitié de
son niveau d’il y a dix ans. Il y a aussi eu une volte-face remarquable
dans le secteur de la fabrication. Ni la construction ni la fabrication n’ont
besoin de travailleurs très instruits car ces deux industries emploient
46% de travailleurs qui n’ont pas d’études postsecondaires.
L’industrie primaire, où la scolarité est la plus réduite,
a continué à faire bande à part sur ce plan. Les mines ont
réduit leurs emplois en réaction à la faiblesse des prix
sur les marchés mondiaux et le secteur forestier a élagué ses
emplois une deuxième année de suite. Dans l’agriculture,
l’emploi s’est stabilisé, mais seulement après le départ
de près du quart des travailleurs agricoles les trois années précédentes.
Dans les services, le taux moyen de croissance de l’emploi est revenu à son
niveau habituel de la fin des années 1990 après avoir brièvement
fléchi en 2001, mais dans sa composition l’emploi a délaissé les
industries où la main-d’œuvre a un bagage universitaire. La
demande a repris dans des services de consommation – comme ceux des
secteurs du commerce et de l’hôtellerie et de la restauration – où la
main-d’œuvre est relativement moins instruite, la moitié des
travailleurs n’y ayant pas fait d’études postsecondaires.
L’emploi s’est également enlisé dans le groupe professionnel,
scientifique et technique (où la main-d’œuvre est la plus instruite
du secteur privé) après une décennie de croissance ininterrompue à une
cadence annuelle moyenne de près de 7%. Cette industrie comprend la conception
de systèmes informatiques où le ralentissement a été remarquable
après la disparition de la « bulle technologique ».
Les services d’information, de culture et de loisirs ont aussi subi un
revers après des années de progression incessante et rapide.
Dans certains services, l’emploi a continué à battre son
plein. Les services de gestion et d’administration ont dominé à l’échelle
des industries avec une croissance à deux chiffres qui s’est maintenue
pour les services aux entreprises (où il y a eu passage du simple au double
après 1998 et au triple depuis 1994, les entreprises ayant de plus en
plus recours à la sous-traitance) avec en complément une reprise
dans les services de construction et de sécurité privée.
Les gains qui suivaient en importance ont été relevés dans
les services publics : la santé et l’éducation ont rebondi
après une accalmie en 2001 et les administrations publiques ont offert
leur premier gain appréciable depuis 1992. L’administration est
le seul secteur ayant une prépondérance de travailleurs du savoir
qui affiche une croissance supérieure à la moyenne (avec près
de 70% de femmes, ceci a aussi contribué à relever leur emploi).
Il est bon de remettre l’évolution l’an dernier de l’emploi
selon l’industrie dans la perspective des tendances à long terme
depuis 1989. De 1989 à 1993, l’économie a perdu des emplois
dans son adaptation à la récession et sa réorganisation
en réaction à divers éléments d’évolution
structurelle (dont l’avènement du libre-échange, l’imposition
de la TPS et l’adoption d’une politique de rigueur monétaire
visant à combattre l’inflation). Le secteur de la fabrication a
dominé dans les compressions d’emplois. Des pertes d’emplois
dans les secteurs de la construction et des ressources se sont ajoutées à la
faiblesse de l’emploi dans les industries de distribution et de manutention
de biens (plus particulièrement dans les industries du transport et du
commerce de gros). Comme les secteurs de la consommation et de la technologie étaient
faibles eux aussi, le secteur public (santé, éducation et administration
publique) a dû porter seul le fardeau du soutien de l’emploi.
De 1993 à 1999, l’emploi s’est accéléré.
Si on regarde en arrière, on peut voir cette période comme l’âge
d’or du commerce et de la technologie. La fabrication s’est revitalisée,
surtout grâce aux exportations d’appareils de télécommunication
et d’automobiles et, à elle seule, la conception de systèmes
informatiques a contribué pour moitié à l’apparition
de 300 000 emplois professionnels, scientifiques et techniques de plus.
Les secteurs des transports et du commerce de gros ont vu chacun leur nombre
d’emplois augmenter de plus de 100 000 dans une progression des courants
de biens échangeables. Les secteurs de l’information et des loisirs
en ont fait autant, stimulés par les progrès des communications
sans fil, des canaux spécialisés de télévision et
des jeux de hasard. Pendant ce temps, le secteur public assistait à une
décroissance appréciable de ses emplois. Tableau 1: Emploi selon l'industrie, 1989-2002
(changement en milliers)*
| |
1989-1993 |
1993-1999 |
1999-2002 |
| |
|
|
|
| Total |
-129 |
1 674 |
881 |
| |
(-0,2%) |
(2,1%) |
(3,0%) |
| Primaires1 |
-38 |
-66 |
-59 |
| Construction |
-118 |
81 |
108 |
| Fabrication |
-344 |
431 |
109 |
| Transports |
-43 |
124 |
11 |
| Commerce de gros |
-7 |
120 |
18 |
| Commerce de détail |
-7 |
88 |
164 |
| Information et loisirs2 |
-3 |
212 |
69 |
| Hébergement et restauration |
40 |
140 |
79 |
| Finances |
25 |
22 |
33 |
| Professionnels et techniques |
63 |
287 |
89 |
| Gestion et services aux entreprises |
33 |
164 |
84 |
| Enseignement |
76 |
74 |
33 |
| Santé |
125 |
88 |
163 |
| Administration publique |
68 |
-91 |
4 |
| |
|
|
|
| * Variation moyenne en pourcentage entre parenthèses. |
| 1 Inclut les services publics. |
| 2 Inclut d'autres services. |
Depuis qu’a crevé la bulle de la technologie – avec un
ralentissement concomitant des échanges dans l’économie mondiale –,
la croissance de l’emploi a hautement été tributaire des
industries liées à la consommation des ménages. Si le nombre
total d’emplois s’est accru de près de 900 000 depuis
1999, on en doit directement environ la moitié à la construction
(surtout à cause du marché de l’habitation), au commerce
de détail (surtout à cause des biens et services liés à l’habitation), à l’hôtellerie-restauration,
aux jeux de hasard et aux autres services récréatifs. Nous ne tenons
pas compte ici des gains relevés dans le secteur de la fabrication, où l’emploi
a délaissé dans sa progression l’éclatant secteur
de la haute technologie pour des secteurs plus ordinaires comme ceux des aliments
et des meubles. D’autres secteurs de haut vol comme ceux des transports,
du commerce de gros, de la radiodiffusion et des télécommunications
sont revenus sur terre, tout comme les services professionnels, scientifiques
et techniques où, en 2002, la conception de systèmes informatiques
devait présenter ce qui était seulement sa deuxième perte
annuelle d’emplois jamais observée. Pendant ce temps, la santé et
l’éducation se ranimaient nettement grâce à une réinjection
de fonds.
Il n’y a que trois secteurs où la tendance n’ait pas changé pendant
ces trois périodes. L’industrie primaire (ce qui comprend les services
publics) a vu l’emploi diminuer sans cesse. Aux pertes d’emplois
qui se multipliaient en agriculture se sont ajoutées des baisses d’emplois
imputables aux moratoires sur les pêches et aux compressions dans l’exploitation
forestière. La faiblesse des prix des produits minéraux a laissé l’emploi
dans les mines (le secteur pétrolier est exclu) à la moitié seulement
de son niveau de 1989. Le secteur des finances et des affaires immobilières
a connu seulement une progression infime de l’emploi : sans une flambée
de croissance dans le secteur du commerce des valeurs mobilières vers
la fin de la dernière décennie, il n’y aurait pas eu de gain
du tout. Dans les services de gestion et autres services aux entreprises, l’emploi
a été en croissance soutenue tout au long de ces années.
Une brusque contraction des services de placement temporaire et de voyages ces
deux dernières années a suivi une décennie de croissance
rapide, mais la demande qui s’attache aux services aux entreprises est
demeurée ferme.
Cette vaste évolution de la demande dans l’industrie se retrouve
dans les données détaillées sur les professions. Depuis
trois ans, les emplois se sont multipliés le plus dans la vente (ce qui
comprend les commis et les caissiers des comptoirs de vente au détail)
et les métiers de la construction. Il y a aussi eu une solide demande
d’enseignants et de travailleurs de la santé. De tous les groupes,
ce sont ceux où une pénurie croissante de main-d’œuvre
l’an dernier a fait le plus baisser les taux de chômage. Ce sont
aussi les seuls groupes où ces taux aient évolué en baisse
l’an dernier, si on exclut le groupe des opérateurs de machines
dans le secteur de la fabrication. Dans les sciences naturelles et sociales,
l’emploi a aussi présenté de solides gains.
Les professions propres à l’industrie primaire sont en décroissance
depuis dix ans, d’où pour elles la triste distinction de constituer
la seule catégorie professionnelle où le chômage soit à deux
chiffres (10,5%). On ne s’étonnera pas que, dans ce secteur, la
main-d’œuvre ait rétréci, les gens le délaissant
pour sonder les possibilités d’emploi qui s’offrent ailleurs
ou prendre leur retraite. Après avoir un peu diminué de 4% de 1987 à 1998,
cette main-d’œuvre a transformé son exode
en hémorragie pour péricliter de 12% les trois années suivantes12.
Le seul autre secteur où la main-d’œuvre se soit contractée
ces dernières années est celui de la gestion, en baisse de 4% depuis
l’an 2000, ce qui s’explique peut-être par les rachats
d’états de service et les retraites anticipées. Néanmoins,
chez les cadres supérieurs, le taux de chômage s’est élevé le
plus à 3,5%, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis la récession
de 1991-1992.
Tant l’emploi et à plein temps que l’emploi à temps
partiel ont repris l’an dernier. Le relèvement de 5,6% de l’emploi à temps
partiel était le plus important depuis presque deux décennies.
Cette progression s’expliquerait autant par les préférences
personnelles (ce qui comprend la fréquentation scolaire) que par une conjoncture
où s’assombrissent les perspectives de travail à plein temps.
L’augmentation du travail à temps partiel est une des raisons pour
lesquelles le nombre moyen d’heures travaillées a reculé de
0,4% dans l’économie, malgré l’évolution en
hausse de l’emploi global. Ajoutons que le nombre de gens faisant de longues
semaines de 50 heures et plus a décru une deuxième année
de suite pour tomber à 12,3% en proportion de l’emploi, le plus
bas depuis 1986. Il y a deux ans seulement au point de culmination de l’économie,
ce groupe prenait des proportions presque records de 13,7% de toute la population
occupée. Un aspect plus singulier encore de la situation est que le nombre
de personnes faisant de longues semaines de travail a diminué malgré un
bond du cumul d’emplois de 10% après deux années de baisse.
Ce cumul a été concentré dans les services, plus particulièrement
dans les services de santé et d’éducation.
La perception généralisée d’un relâchement des
liens entre les employeurs et les salariés ne paraissait pas sur le marché du
travail. L’emploi temporaire a crû plus rapidement que l’emploi
permanent depuis cinq ans, mais l’écart observé l’an
dernier était le plus petit jamais constaté (3,4% contre 2,2%;
l’emploi saisonnier dominait au tableau des hausses de l’emploi temporaire).
Dans leur très vaste majorité (87%), les emplois sont restés
permanents, n’ayant que légèrement reculé depuis les
88,7% de 1997. De cette stabilité témoignait la durée moyenne
d’occupation des emplois qui, après quatre baisses consécutives,
devait bondir pour presque égaler le maximum record établi en 1997.
Bien sûr, si on occupe plus longtemps un emploi, c’est souvent qu’on
traverse une période économique d’anxiété où les
gens hésiteront à quitter leur travail devant des taux d’embauchage
en chute libre (la durée d’occupation des emplois a fait des bonds,
par exemple, pendant une période record de cinq mois dans la récession
de 1990-1992).
Marchés des produits
Les entreprises ont recommencé à augmenter leurs stocks en 2002,
après les avoir réduits en 2001, alors que les ventes s’amenuisaient.
Ce changement dans les stocks est responsable de pratiquement toute la différence
entre la croissance réelle de 1,5% en 2001 et celle de 3,4% l’an
dernier. Si on ne tient pas compte des stocks, la croissance aurait été de
2,9% et de 2,6% respectivement. La plus grande partie de la reprise des stocks
l’an dernier est attribuable aux détaillants, en particulier les
détaillants d’automobiles, chez qui la demande s’est le plus
améliorée. Les fabricants ont gardé un oeil vigilant sur
les niveaux de stocks.
La fermeté du PIB, mis à part les stocks, s’est concrétisée
dans la demande intérieure finale, où la croissance réelle
de 2,6% était pratiquement la même que l’année précédente.
Tandis que l’habitation montait en flèche de 16%, de loin sa croissance
la plus rapide depuis 1987, la chute rapide de l’investissement des entreprises
amortissait grandement la situation. La croissance des dépenses des consommateurs
en biens et services a peu changé, à un peu moins de 3%, malgré l’augmentation
momentanée des ventes de véhicules.
Le commerce extérieur est demeuré lent pour une deuxième
année de suite, alourdi par la chute de la demande de machines et d’équipement
des deux côtés de la frontière. Le volume des exportations
n’a repris qu’une fraction des pertes de l’année précédente,
tandis que les gains s’écroulaient pour une deuxième année
de suite en raison de la baisse radicale des prix d’une grande variété de
produits de base. Les importations se portaient légèrement mieux
grâce à la forte demande pour les autos et d’autres biens
de consommation.
Le climat inhabituel a eu des répercussions importantes sur de grands
secteurs de l’économie. La tendance au réchauffement s’est
poursuivie, accompagnée d’une sécheresse persistante dans
l’Ouest du Canada. La récolte de blé s’en est trouvée
amoindrie à 15,45 millions de tonnes métriques, un quart de la
production de 2001 et à peine un peu plus de la moitié des 26,8
millions de tonnes récoltées en 2000. La mauvaise température
au centre du Canada a aussi nui aux récoltes de légumes, en particulier à celle
du maïs. Les répercussions sur les prix des aliments ont été variées.
L’augmentation du prix du pain a été mitigée par l’abattage
précoce du bétail (pour réduire le coût d’alimentation
des animaux). Dans l’ensemble, le prix des aliments a augmenté de
2,6% de moins que l’année précédente.
Ailleurs, le temps généralement plus doux a eu des résultats
variables. Dans le secteur de l’habitation où la demande avait poussé à la
limite les capacités de l’industrie toute l’année,
le temps le plus clément jamais observé en début d’année
a probablement eu pour effet d’amplifier la production globale. Les services
publics ont pu oublier la faiblesse de la demande de chauffage pendant l’hiver
lorsque la demande a monté en flèche dans un été de
chaleurs inégalées.
Un autre grand facteur de divergence entre le Canada et les États-Unis
est apparu le 11 septembre. Les attentats terroristes ont provoqué de
part et d’autre de la frontière de grandes pertes dans des industries
aussi diverses que celles des transports aériens, de l’hébergement
et des jeux de hasard, mais presque toutes s’étaient entièrement
rétablies au Canada dans les trois mois qui avaient suivi. La seule exception à cet égard était
le tourisme d’un jour de provenance américaine, mais pour compenser
en partie, il y avait un accroissement du tourisme d’outre-mer qui boudait
les États-Unis. Les industries américaines correspondantes ne se
sont pas remises des attentats et les licenciements qui ont eu lieu dans les
transports aériens, l’aérospatiale et le tourisme sont demeurés
une importante source de pertes d’emplois en 2002.
L’écart canado-américain n’a jamais été aussi
grand que dans le secteur de la fabrication. L’un et l’autre de ces
pays ont essuyé des pertes en 2001 par les premiers effets de l’affaissement
des investissements en technologie et des attentats terroristes, mais la croissance
a vite repris au Canada; ce secteur a vu le nombre de ses emplois s’élever
de 2,2% l’an dernier à l’inverse de ce qui se produisait aux États-Unis
où les fabricants éliminaient encore 5 % de leurs emplois en 2002
pour ainsi faire tomber cet indicateur à son plus bas niveau en 41 ans.
Divers facteurs ont joué dans ce plus grand écart canado-américain,
mais un des principaux semble être le taux de change. Légèrement
dévalorisé l’an dernier, le dollar américain reste à des
niveaux presque records, soutenu par un véritable afflux de capitaux au
sommet de l’activité boursière. Une des victimes en a été le
dollar canadien, qui est tombé à un niveau sans précédent
de 63.7 cents américains avant de se redresser en fin d’année.
Conclusion
La descente qui a suivi la chute des marchés boursiers à travers
le monde après l’éclatement de la bulle technologique a dominé l’ensemble
des développements économiques l’an dernier. L’investissement
a baissé une deuxième année de suite au Canada, tandis que
les coupures de dépenses effectuées par les entreprises à travers
le monde ont entraîné dans leur sillon les exportations. La chute
cyclique du commerce et de la technologie a freiné l’avantage dont
avait bénéficié les travailleurs plus scolarisés
tout au long des années 1990. Quand même, la croissance au Canada était
soutenue par des gains rapides des dépenses des ménages qui ont
fait suite à la baisse des taux d’intérêt, les diminutions
d’impôt et un marché du travail en santé. La forte
croissance de l’emploi relié à la consommation a soutenu
l’augmentation globale, en particulier pour les femmes qui de plus en plus
dépassent les hommes à ce niveau. Les marchés du travail
ont été touchés de manière croissante par le vieillissement
de la génération du boom des naissances, qui adopte des attitudes
différentes des autres générations à l’approche
de l’âge de la retraite.
Notes
1 Plus bas dans l’échelle du développement, le Mexique
et la Corée du sud connaissaient une croissance légèrement
plus rapide à 32% et 39%. Source : Principaux indicateurs économiques
de l’OCDE, février 2003.
2 Les taux de croissance réels du PIB étaient de 5,4%, 4,5%,
1,5% et 3,4% au Canada, de 1999 à 2002, comparativement à 4,1%,
3,8% et 0,3% et 2,4% aux États-Unis.
3 J.Stiglitz, « The Roaring Nineties » dans The Atlantic
Monthly, October 2002,
p. 82.
4 La crise en Asie de l’est a commencé avec l’effondrement
de la devise thaï en juillet 1997 et s’est propagée en Malaisia,
en Corée, aux Philippines et en Indonésie. La crise du fonds
Long Term Capital Management a été déclenchée par
le déclin du rouble russe en juillet 1998. Voir J.Stiglitz, p. 83-84.
5 Voir R.J.Shiller, « Irrational Exuberance », Princeton
University Press, 2000,
p. 101-105.
6 La banque du Canada, « Revue du système financier », décembre,
p. 5.
7 Au R.-U. une baisse de 3,2 milliards de livres dans les investissements entre
le milieu de 2001 et 2002 a accompagné un mouvement d’emprunt
net de
3,8 milliards de livres à des prêts nets de 2,3 milliards de livres
(p. 5, Economic Trends, Office of National Statistics, février 2003).
Aux É.-U., les emprunts nets des sociétés sont tombés
de près de 200 milliards de dollars en 2001. Les données de 2002
ne sont pas encore publiées.
8 Chaque secteur a son comportement particulier; les employés du secteur
public prennent une retraite précoce, mais affichent la plus grande
augmentation des dernières années, de 57,8 ans en 1998 à 58,4
ans. Les travailleurs autonomes prennent la retraite la plus tardive, plus
tard que 65 ans partout. Les travailleurs du secteur privé ont l’augmentation
la plus modeste des dernières années, en hausse de seulement
0,2 points depuis 2000, à 61,3 ans.
9 Ces deux tendances étaient évidentes aux États-Unis,
où le taux d’emploi a augmenté pour les 55 à 64
ans, le seul groupe à afficher une augmentation : leur durée
du chômage était de 20,6 semaines, comparativement à une
moyenne de 16,6 semaines.
10 La montée rapide réelle de l’emploi à temps partiel
se trouve chez les jeunes, qui a presque doublé, de 21% de tous les
emplois en 1976, à 45% en 2002. En tête se trouvent les jeunes
femmes, ce qui est conforme à l’évidence de plus en plus
grande de réussite académique.
11 Cette tendance est encore plus marquée aux États-Unis où le
taux d’emploi des diplômés universitaires a dégringolé de
2 points et le taux de chômage a augmenté de 1,3 points au cours
des huit derniers trimestres, ce qui est cependant conforme à la détérioration
remarquée dans les autres groupes.
12 Ces données reposent sur les emplois propres aux industries primaires.
Les données plus générales sur la population active de
toutes les industries du secteur primaire indiquent une chute de 16% depuis
1998, suivant un soubresaut de 4% au cours de la décennie précédente.
Bien que cet exode soit important en comparaison à la main-d’oeuvre
des emplois primaires, il n’a eu que peu de répercussions sur
les autres principaux agrégats et équivaut à moins de
2% des cols bleus ou des travailleurs moins instruits.
Études spéciales récemment
parues
* Groupe d'analyse de conjoncture.
|


































 Consulter la version la plus récente.
Consulter la version la plus récente.